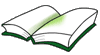A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
Détail de l'éditeur
Brepols
localisé à :
Turnhout
Collections rattachées :
|
Documents disponibles chez cet éditeur


 Affiner la recherche
Affiner la rechercheLes cérémoniaux catholiques en France à l'époque moderne
Titre : Les cérémoniaux catholiques en France à l'époque moderne : une littérature de codification des rites liturgiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Cécile Davy-Rigaux, Editeur scientifique ; Bernard Dompnier, Editeur scientifique ; Daniel-Odon Hurel (1963-....), Editeur scientifique Editeur : Turnhout : Brepols Année de publication : 2009 Collection : Église, liturgie et société dans l'Europe moderne num. 1 Importance : 1 vol. (560 p.) Format : 28 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-503-52950-9 Note générale : Nombreuses références aux cérémoniaux du diocèse de Besançon Langues : Français Résumé : Ouvrage post-tridentin par excellence, le Caeremoniale episcoporum publié par Clément VIII en 1600 a engendré une importante production de cérémoniaux à usage romain, diocésain et monastique, qui s’est développée durant l’époque moderne et au-delà. Cette littérature encore non explorée systématiquement jusqu’à présent constitue une source de premier ordre pour l’histoire du culte catholique, l’histoire des pratiques et normes culturelles et, plus généralement, pour examiner l’ensemble des rapports entre Église et société. Traitant du déroulement extérieur de la liturgie, le cérémonial est censé décrire, régenter et fixer les usages d’une assemblée religieuse plus ou moins vaste ; il permet d’observer la diversité ou la régularité des pratiques, de même que les enjeux identitaires, hiérarchiques ou politiques qui se dessinent en arrière-plan. Objet riche et complexe, il offre une multitude de niveaux de lecture qui en font une source exemplaire, tant pour l’étude des diverses réalités sonores et visuelles mises en œuvre dans les sanctuaires, que pour l’approche des systèmes de représentation d’Ancien Régime. Par son caractère interdisciplinaire (sont rassemblées ici les contributions d’historiens, d’historiens du livre, de musicologues et de liturgistes), par l’expérimentation des approches et des méthodes qu’il propose, le présent ouvrage collectif ambitionne de constituer à la fois un premier bilan à partir du corpus des cérémoniaux publiés en France entre 1600 et 1800 et une introduction aux études historiques des sources liturgiques en France et en Europe Les cérémoniaux catholiques en France à l'époque moderne : une littérature de codification des rites liturgiques [texte imprimé] / Cécile Davy-Rigaux, Editeur scientifique ; Bernard Dompnier, Editeur scientifique ; Daniel-Odon Hurel (1963-....), Editeur scientifique . - Turnhout : Brepols, 2009 . - 1 vol. (560 p.) ; 28 cm. - (Église, liturgie et société dans l'Europe moderne; 1) .
ISBN : 978-2-503-52950-9
Nombreuses références aux cérémoniaux du diocèse de Besançon
Langues : Français
Résumé : Ouvrage post-tridentin par excellence, le Caeremoniale episcoporum publié par Clément VIII en 1600 a engendré une importante production de cérémoniaux à usage romain, diocésain et monastique, qui s’est développée durant l’époque moderne et au-delà. Cette littérature encore non explorée systématiquement jusqu’à présent constitue une source de premier ordre pour l’histoire du culte catholique, l’histoire des pratiques et normes culturelles et, plus généralement, pour examiner l’ensemble des rapports entre Église et société. Traitant du déroulement extérieur de la liturgie, le cérémonial est censé décrire, régenter et fixer les usages d’une assemblée religieuse plus ou moins vaste ; il permet d’observer la diversité ou la régularité des pratiques, de même que les enjeux identitaires, hiérarchiques ou politiques qui se dessinent en arrière-plan. Objet riche et complexe, il offre une multitude de niveaux de lecture qui en font une source exemplaire, tant pour l’étude des diverses réalités sonores et visuelles mises en œuvre dans les sanctuaires, que pour l’approche des systèmes de représentation d’Ancien Régime. Par son caractère interdisciplinaire (sont rassemblées ici les contributions d’historiens, d’historiens du livre, de musicologues et de liturgistes), par l’expérimentation des approches et des méthodes qu’il propose, le présent ouvrage collectif ambitionne de constituer à la fois un premier bilan à partir du corpus des cérémoniaux publiés en France entre 1600 et 1800 et une introduction aux études historiques des sources liturgiques en France et en Europe Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0074376 4O3 Livres Magasin Pastorale Exclu du prêt Approches du bilinguisme latin-français au Moyen Âge
Titre : Approches du bilinguisme latin-français au Moyen Âge : Linguistique, codicologie, esthétique Type de document : texte imprimé Auteurs : Stéphanie Le Briz (19..-....), Editeur scientifique ; Géraldine Veysseyre, Editeur scientifique Editeur : Turnhout : Brepols Année de publication : 2011 Collection : Collection du Centre d'études médiévales de Nice, ISSN 1281-6809 num. 11 Importance : 1 vol. (518 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-503-53580-7 Note générale : Cette publication fait suite aux journées d'études qui se sont tenues les 5 octobre 2007 et 3-4 octobre 2008. Bibliogr. p. 451-472 Langues : Français Résumé : Le Moyen Âge a vu naître les langues romanes. L’émergence progressive de ces nouveaux systèmes linguistiques, puis leur accession à l’écrit et à la littérature, n’a pourtant pas rendu caduc l’usage du latin. Témoignent de cette résistance du latin la diglossie de nombreux locuteurs, auteurs ou copistes médiévaux, ainsi que le bilinguisme courant de leurs énoncés et de leurs productions textuelles. Ces phénomènes ont été éclairés et illustrés par d’abondants travaux dont l’apport est régulièrement signalé par les auteurs de ce volume. L’originalité du présent recueil tient au fait qu’y sont analysées les modalités de cohabitation du latin et de la langue d’oïl dans les textes du Moyen Âge central et tardif. Cette réflexion collective, adossée à un souci permanent de définition théorique, se montre attentive à l’évolution chronologique, depuis les Psautiers bilingues du xiie siècle jusqu’aux imprimés du xvie siècle. Elle est sensible aussi à des enjeux variables, depuis l’enseignement élémentaire de la grammaire ou du vocabulaire jusqu’à la mise en œuvre de dispositifs esthétiques complexes. En s’appuyant sur les témoins – pour la plupart manuscrits – qu’a pu susciter la double compétence linguistique médiévale, les auteurs du volume interrogent la conception des textes bilingues, leurs conditions d’élaboration, leur transmission, leur réception. L’insertion souvent discrète de fragments latins au sein de textes français, tout comme la présence plus rare de la langue d’oïl au sein de manuscrits latins, se lit alors comme un mode d’expression aussi raffiné que spontané, susceptible d’enrichir les usages prévus pour le texte enchâssant. Au-delà, l’ensemble de ces études permet d’entrevoir la conscience linguistique des locuteurs du Moyen Âge. Approches du bilinguisme latin-français au Moyen Âge : Linguistique, codicologie, esthétique [texte imprimé] / Stéphanie Le Briz (19..-....), Editeur scientifique ; Géraldine Veysseyre, Editeur scientifique . - Turnhout : Brepols, 2011 . - 1 vol. (518 p.) : ill. ; 24 cm. - (Collection du Centre d'études médiévales de Nice, ISSN 1281-6809; 11) .
ISBN : 978-2-503-53580-7
Cette publication fait suite aux journées d'études qui se sont tenues les 5 octobre 2007 et 3-4 octobre 2008. Bibliogr. p. 451-472
Langues : Français
Résumé : Le Moyen Âge a vu naître les langues romanes. L’émergence progressive de ces nouveaux systèmes linguistiques, puis leur accession à l’écrit et à la littérature, n’a pourtant pas rendu caduc l’usage du latin. Témoignent de cette résistance du latin la diglossie de nombreux locuteurs, auteurs ou copistes médiévaux, ainsi que le bilinguisme courant de leurs énoncés et de leurs productions textuelles. Ces phénomènes ont été éclairés et illustrés par d’abondants travaux dont l’apport est régulièrement signalé par les auteurs de ce volume. L’originalité du présent recueil tient au fait qu’y sont analysées les modalités de cohabitation du latin et de la langue d’oïl dans les textes du Moyen Âge central et tardif. Cette réflexion collective, adossée à un souci permanent de définition théorique, se montre attentive à l’évolution chronologique, depuis les Psautiers bilingues du xiie siècle jusqu’aux imprimés du xvie siècle. Elle est sensible aussi à des enjeux variables, depuis l’enseignement élémentaire de la grammaire ou du vocabulaire jusqu’à la mise en œuvre de dispositifs esthétiques complexes. En s’appuyant sur les témoins – pour la plupart manuscrits – qu’a pu susciter la double compétence linguistique médiévale, les auteurs du volume interrogent la conception des textes bilingues, leurs conditions d’élaboration, leur transmission, leur réception. L’insertion souvent discrète de fragments latins au sein de textes français, tout comme la présence plus rare de la langue d’oïl au sein de manuscrits latins, se lit alors comme un mode d’expression aussi raffiné que spontané, susceptible d’enrichir les usages prévus pour le texte enchâssant. Au-delà, l’ensemble de ces études permet d’entrevoir la conscience linguistique des locuteurs du Moyen Âge. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0076377 8J1917 Livres Magasin Histoire Exclu du prêt Les Apôtres Thaddée et Barthélemy
Titre : Les Apôtres Thaddée et Barthélemy : aux origines du christianisme arménien Type de document : texte imprimé Auteurs : Valentina Calzolari Bouvier, Editeur scientifique Editeur : Turnhout : Brepols Année de publication : 2011 Collection : Apocryphes (Paris), ISSN 1263-946X num. 13 Importance : 1 vol. (257 p.) Format : 19 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-503-54037-5 Note générale : Contient : "Martyre et découverte des reliques de Thaddée ; Martyre et découverte des reliques de Barthélemy" Bibliogr. p. 207-216 Langues : Français Résumé : Les textes arméniens présentés et traduits dans ce volume relatent les circonstances de la prédication et du martyre des apôtres Thaddée et Barthélemy en Arménie, à l'époque du roi Sanatrouk. Les deux apôtres y apparaissent comme les fondateurs de l'Église arménienne, bien avant l'œuvre évangélisatrice de Grégoire l'Illuminateur, au début du IVe siècle, lorsque le royaume d'Arménie adopta, le premier, le christianisme comme religion d'État. Livrant bataille aux démons et aux divinités mazdéennes, dans des récits imprégnés de mythologie païenne, les deux apôtres œuvrent à l'accomplissement d'un plan divin qui fait du peuple arménien le nouveau peuple élu. Sur le modèle de l'histoire biblique, ces textes apocryphes participent en effet de la même visée que la pensée historiographique arménienne des origines et contribuent à inscrire le peuple arménien dans l'Historia sacra. Faisant suite aux Martyres, les deux récits de la Découverte des reliques des apôtres sur le sol arménien veulent apporter une caution d'authenticité à la tradition de leur mission. À l'époque des querelles christologiques qui suivirent le concile de Chalcédoine (451), le label d'apostolicité offert par les textes apocryphes légitima la politique d’affranchissement de l'Église arménienne, anti-chalcédonienne, par rapport à l’Église byzantine. De nos jours encore, l'Église d'Arménie, autocéphale depuis le VIe-VIIe siècle, s'appelle officiellement « Église apostolique arménienne ». Les Apôtres Thaddée et Barthélemy : aux origines du christianisme arménien [texte imprimé] / Valentina Calzolari Bouvier, Editeur scientifique . - Turnhout : Brepols, 2011 . - 1 vol. (257 p.) ; 19 cm. - (Apocryphes (Paris), ISSN 1263-946X; 13) .
ISBN : 978-2-503-54037-5
Contient : "Martyre et découverte des reliques de Thaddée ; Martyre et découverte des reliques de Barthélemy" Bibliogr. p. 207-216
Langues : Français
Résumé : Les textes arméniens présentés et traduits dans ce volume relatent les circonstances de la prédication et du martyre des apôtres Thaddée et Barthélemy en Arménie, à l'époque du roi Sanatrouk. Les deux apôtres y apparaissent comme les fondateurs de l'Église arménienne, bien avant l'œuvre évangélisatrice de Grégoire l'Illuminateur, au début du IVe siècle, lorsque le royaume d'Arménie adopta, le premier, le christianisme comme religion d'État. Livrant bataille aux démons et aux divinités mazdéennes, dans des récits imprégnés de mythologie païenne, les deux apôtres œuvrent à l'accomplissement d'un plan divin qui fait du peuple arménien le nouveau peuple élu. Sur le modèle de l'histoire biblique, ces textes apocryphes participent en effet de la même visée que la pensée historiographique arménienne des origines et contribuent à inscrire le peuple arménien dans l'Historia sacra. Faisant suite aux Martyres, les deux récits de la Découverte des reliques des apôtres sur le sol arménien veulent apporter une caution d'authenticité à la tradition de leur mission. À l'époque des querelles christologiques qui suivirent le concile de Chalcédoine (451), le label d'apostolicité offert par les textes apocryphes légitima la politique d’affranchissement de l'Église arménienne, anti-chalcédonienne, par rapport à l’Église byzantine. De nos jours encore, l'Église d'Arménie, autocéphale depuis le VIe-VIIe siècle, s'appelle officiellement « Église apostolique arménienne ». Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0074415 8C1531/13 Livres Magasin Bible Disponible La prière en latin de l'Antiquité au XVIe siècle / Jean François Cottier
Titre : La prière en latin de l'Antiquité au XVIe siècle : Formes, évolutions, significations Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean François Cottier, Editeur scientifique Editeur : Turnhout : Brepols Année de publication : 2006 Collection : Collection du Centre d'études médiévales de Nice, ISSN 1281-6809 num. 6 Importance : 1 vol. (519 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-503-51832-9 Langues : Français Mots-clés : Prière Dévotion Résumé : À un moment où plusieurs travaux sont consacrés à la prière et où cette question semble de plus en plus intéresser la communauté scientifique, une trentaine de spécialistes - littéraires, linguistes, historiens, philosophes, théologiens - se sont réunis à Nice afin d’étudier les formes, les évolutions et les significations de la prière en latin, depuis ses origines étrusco-italiques jusqu’à la Réforme protestante. C’est ainsi plus de vingt siècles de textes eucologiques latins qui sont abordés, selon des perspectives et des approches différentes mais complémentaires, dans un dialogue riche de débats. L’ouvrage présente tout d’abord, sur un objet central dans l’histoire de l’Occident latin, corpus des sources et problématiques : écriture et oralité, liturgie et dévotion personnelle, ruptures et continuités entre la prière païenne et chrétienne... Il illustre ensuite la rencontre entre des chercheurs de disciplines diverses qui ont entrepris d’étudier la prière latine dans toutes ses harmoniques, ainsi que sa place dans différentes sociétés : civilisation romaine, Antiquité chrétienne, Moyen âge occidental, Réforme protestante et réaction catholique. Ce livre offre enfin une large matière à réflexions pour tous ceux qui s’intéressent au sacré et à son expression. (4ème de couv.) La prière en latin de l'Antiquité au XVIe siècle : Formes, évolutions, significations [texte imprimé] / Jean François Cottier, Editeur scientifique . - Turnhout : Brepols, 2006 . - 1 vol. (519 p.) ; 24 cm. - (Collection du Centre d'études médiévales de Nice, ISSN 1281-6809; 6) .
ISBN : 978-2-503-51832-9
Langues : Français
Mots-clés : Prière Dévotion Résumé : À un moment où plusieurs travaux sont consacrés à la prière et où cette question semble de plus en plus intéresser la communauté scientifique, une trentaine de spécialistes - littéraires, linguistes, historiens, philosophes, théologiens - se sont réunis à Nice afin d’étudier les formes, les évolutions et les significations de la prière en latin, depuis ses origines étrusco-italiques jusqu’à la Réforme protestante. C’est ainsi plus de vingt siècles de textes eucologiques latins qui sont abordés, selon des perspectives et des approches différentes mais complémentaires, dans un dialogue riche de débats. L’ouvrage présente tout d’abord, sur un objet central dans l’histoire de l’Occident latin, corpus des sources et problématiques : écriture et oralité, liturgie et dévotion personnelle, ruptures et continuités entre la prière païenne et chrétienne... Il illustre ensuite la rencontre entre des chercheurs de disciplines diverses qui ont entrepris d’étudier la prière latine dans toutes ses harmoniques, ainsi que sa place dans différentes sociétés : civilisation romaine, Antiquité chrétienne, Moyen âge occidental, Réforme protestante et réaction catholique. Ce livre offre enfin une large matière à réflexions pour tous ceux qui s’intéressent au sacré et à son expression. (4ème de couv.) Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0074143 8T6647 Livres Magasin Spiritualité Disponible