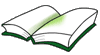A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
Détail d'une collection
|
|
Documents disponibles dans la collection


 Affiner la recherche
Affiner la rechercheL'Aubier, la JOC et la JOCF dans le diocèse de Besançon 1927-1978 / Jean Divo
Titre : L'Aubier, la JOC et la JOCF dans le diocèse de Besançon 1927-1978 Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean Divo, Auteur ; Gérard Cholvy, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Éd. du Cerf Année de publication : 2015 Collection : Histoire religieuse de la France, ISSN 1248-6396 Importance : 1 vol. (368 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-204-10019-9 Langues : Français Mots-clés : Jeunesse Ouvrière Chrétienne Action Catholique Résumé : Dans le diocèse de Besançon, le mouvement de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) est né en 1927, à une époque où les enfants des milieux populaires entrent à l'usine ou à l'atelier à la fin de la scolarité obligatoire fixée alors à 13 ans. La situation de ces jeunes salariés, leur éloignement progressif de l’Église préoccupent certains prêtres. L'abbé Béjot, vicaire à Belfort, est de ceux-là. Aussi, pour que l'entrée dans la vie active ne soit pas le fruit du hasard, la JOC organise un service d'orientation professionnelle ; pour faciliter l'entrée dans l'entreprise, elle met au point un système de parrainage. Face au chômage des jeunes, elle crée un service de placement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la JOC, hostile au nazisme, poursuit son action malgré l'interdiction de l'Occupant. Elle résiste à la tentative de Vichy de créer une Jeunesse unique, à la nazification des esprits en France ou en Allemagne au temps du STO, où les jocistes participent à la résistance spirituelle en créant des sections clandestines. C'est dans le diocèse de Besançon que s'inaugure le passage de la révision d'influence à la révision de vie. Si c'est un jociste bisontin qui donne la chiquenaude initiale, l'influence de la philosophie blondélienne parmi le jeune clergé et certains professeurs du Grand séminaire, permet à l'abbé Béjot de construire une spiritualité plus réceptive aux " richesses de la masse ". Cette méthode gagne peu à peu les autres mouvements d'Action catholique. S'engager dans le mouvement est une expérience enrichissante. Au cours du cercle d'études où l'on dépouille les enquêtes, l'observation de la réalité du quotidien confronté à l’Évangile aiguise le regard. E n cherchant à fournir à ces jeune s travailleurs une éducation intégrale, professionnelle, culturelle et spirituelle, la JOC est un facteur d'ouverture. [Source : 4ème de couv.] L'Aubier, la JOC et la JOCF dans le diocèse de Besançon 1927-1978 [texte imprimé] / Jean Divo, Auteur ; Gérard Cholvy, Préfacier, etc. . - Paris : Éd. du Cerf, 2015 . - 1 vol. (368 p.) ; 23 cm. - (Histoire religieuse de la France, ISSN 1248-6396) .
ISBN : 978-2-204-10019-9
Langues : Français
Mots-clés : Jeunesse Ouvrière Chrétienne Action Catholique Résumé : Dans le diocèse de Besançon, le mouvement de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) est né en 1927, à une époque où les enfants des milieux populaires entrent à l'usine ou à l'atelier à la fin de la scolarité obligatoire fixée alors à 13 ans. La situation de ces jeunes salariés, leur éloignement progressif de l’Église préoccupent certains prêtres. L'abbé Béjot, vicaire à Belfort, est de ceux-là. Aussi, pour que l'entrée dans la vie active ne soit pas le fruit du hasard, la JOC organise un service d'orientation professionnelle ; pour faciliter l'entrée dans l'entreprise, elle met au point un système de parrainage. Face au chômage des jeunes, elle crée un service de placement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la JOC, hostile au nazisme, poursuit son action malgré l'interdiction de l'Occupant. Elle résiste à la tentative de Vichy de créer une Jeunesse unique, à la nazification des esprits en France ou en Allemagne au temps du STO, où les jocistes participent à la résistance spirituelle en créant des sections clandestines. C'est dans le diocèse de Besançon que s'inaugure le passage de la révision d'influence à la révision de vie. Si c'est un jociste bisontin qui donne la chiquenaude initiale, l'influence de la philosophie blondélienne parmi le jeune clergé et certains professeurs du Grand séminaire, permet à l'abbé Béjot de construire une spiritualité plus réceptive aux " richesses de la masse ". Cette méthode gagne peu à peu les autres mouvements d'Action catholique. S'engager dans le mouvement est une expérience enrichissante. Au cours du cercle d'études où l'on dépouille les enquêtes, l'observation de la réalité du quotidien confronté à l’Évangile aiguise le regard. E n cherchant à fournir à ces jeune s travailleurs une éducation intégrale, professionnelle, culturelle et spirituelle, la JOC est un facteur d'ouverture. [Source : 4ème de couv.] Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0076997 8R2437 Livres Magasin Régional Disponible Fiat lux : lumière et luminaires dans la vie religieuse en Occident du XIIIe siècle au début du XVIe siècle / Catherine Vincent
Titre : Fiat lux : lumière et luminaires dans la vie religieuse en Occident du XIIIe siècle au début du XVIe siècle Type de document : texte imprimé Auteurs : Catherine Vincent, Auteur Editeur : Paris : Éd. du Cerf Année de publication : 2004 Collection : Histoire religieuse de la France, ISSN 1248-6396 num. 24 Importance : II-693 p.-[24] p. de pl. en noir et en coul. Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-204-07304-2 Prix : 44 EUR Langues : Français Résumé : " Je suis la lumière du monde " proclame le Christ dans l'Évangile selon saint Jean. Entre cette affirmation, longuement commentée par les théologiens et les mystiques, et les humbles gestes accomplis par les clercs et les pèlerins existe une relation fondamentale qui n'avait jamais retenu l'attention des historiens. Catherine Vincent l'étudie en s'appuyant sur les témoignages de la vie religieuse à la fin du Moyen Âge. Récusé par la Réforme, l'usage des signes et des symboles lumineux (torches, bougies, cierges, lustres, vitraux...) joue un rôle important dans la pratique catholique (processions, liturgie, sacrements, cultes des saints) et révèle une passionnante anthropologie religieuse. Fiat lux : lumière et luminaires dans la vie religieuse en Occident du XIIIe siècle au début du XVIe siècle [texte imprimé] / Catherine Vincent, Auteur . - Paris : Éd. du Cerf, 2004 . - II-693 p.-[24] p. de pl. en noir et en coul. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoire religieuse de la France, ISSN 1248-6396; 24) .
ISBN : 978-2-204-07304-2 : 44 EUR
Langues : Français
Résumé : " Je suis la lumière du monde " proclame le Christ dans l'Évangile selon saint Jean. Entre cette affirmation, longuement commentée par les théologiens et les mystiques, et les humbles gestes accomplis par les clercs et les pèlerins existe une relation fondamentale qui n'avait jamais retenu l'attention des historiens. Catherine Vincent l'étudie en s'appuyant sur les témoignages de la vie religieuse à la fin du Moyen Âge. Récusé par la Réforme, l'usage des signes et des symboles lumineux (torches, bougies, cierges, lustres, vitraux...) joue un rôle important dans la pratique catholique (processions, liturgie, sacrements, cultes des saints) et révèle une passionnante anthropologie religieuse. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0079612 8J1955 Livres Magasin Histoire Disponible La ville charitable / Catherine Maurer
Titre : La ville charitable : les oeuvres sociales catholiques en France et en Allemagne au XIXe siècle Type de document : texte imprimé Auteurs : Catherine Maurer, Auteur Editeur : Paris : Éd. du Cerf Année de publication : 2012 Collection : Histoire religieuse de la France, ISSN 1248-6396 num. 39 Importance : 1 vol. (411 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-204-09823-6 Prix : 24 EUR Résumé : Le très populaire abbé Pierre, fondateur du mouvement Emmaüs, est souvent présenté comme un franc-tireur, et l’organisation qu’il a créée comme tout autre chose qu’une œuvre de charité. Pourtant, ses origines et ses objectifs inscrivent bien Emmaüs dans la tradition chrétienne de la « caritas ». Ce livre revient sur ces œuvres que le XIXe siècle ne craignait pas de nommer « de charité ». Les œuvres des villes françaises et allemandes au XIXe siècle, examinées de manière inédite par l’auteur, encadrent alors étroitement la population catholique. Elles sont plus le produit de leur temps que des survivances de l’Ancien Régime. Leurs fondateurs sont issus d’un milieu d’élites laïques, de prêtres diocésains et de religieux congréganistes où les femmes tiennent une place décisive. Leur grande plasticité répond aussi bien à l’héritage chrétien qu’aux besoins nés de la révolution industrielle — travail des mères, migrations de travail, développement des demandes de santé. Émerge alors un véritable secteur « privé », face à l’affirmation de l’intervention « publique ». Au cœur de ce livre est posée la question fondamentale du rapport des catholiques à la modernité. Les œuvres reprennent-elles sans distanciation l’image catholique de la société moderne comme un « corps malade » ? Leurs pratiques témoignent-elles d’un refus persistant de cette modernité sociale à laquelle le discours dominant de l’Église invitait ses fidèles à tourner le dos ? Autant d’interrogations autour d’un continent qui n’est pas tout à fait englouti, mais qui survit aujourd’hui au sein des mouvements caritatifs et humanitaires. La ville charitable : les oeuvres sociales catholiques en France et en Allemagne au XIXe siècle [texte imprimé] / Catherine Maurer, Auteur . - Paris : Éd. du Cerf, 2012 . - 1 vol. (411 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoire religieuse de la France, ISSN 1248-6396; 39) .
ISBN : 978-2-204-09823-6 : 24 EUR
Résumé : Le très populaire abbé Pierre, fondateur du mouvement Emmaüs, est souvent présenté comme un franc-tireur, et l’organisation qu’il a créée comme tout autre chose qu’une œuvre de charité. Pourtant, ses origines et ses objectifs inscrivent bien Emmaüs dans la tradition chrétienne de la « caritas ». Ce livre revient sur ces œuvres que le XIXe siècle ne craignait pas de nommer « de charité ». Les œuvres des villes françaises et allemandes au XIXe siècle, examinées de manière inédite par l’auteur, encadrent alors étroitement la population catholique. Elles sont plus le produit de leur temps que des survivances de l’Ancien Régime. Leurs fondateurs sont issus d’un milieu d’élites laïques, de prêtres diocésains et de religieux congréganistes où les femmes tiennent une place décisive. Leur grande plasticité répond aussi bien à l’héritage chrétien qu’aux besoins nés de la révolution industrielle — travail des mères, migrations de travail, développement des demandes de santé. Émerge alors un véritable secteur « privé », face à l’affirmation de l’intervention « publique ». Au cœur de ce livre est posée la question fondamentale du rapport des catholiques à la modernité. Les œuvres reprennent-elles sans distanciation l’image catholique de la société moderne comme un « corps malade » ? Leurs pratiques témoignent-elles d’un refus persistant de cette modernité sociale à laquelle le discours dominant de l’Église invitait ses fidèles à tourner le dos ? Autant d’interrogations autour d’un continent qui n’est pas tout à fait englouti, mais qui survit aujourd’hui au sein des mouvements caritatifs et humanitaires. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0074732 8J1909 Livres Magasin Histoire Disponible