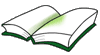| Titre : | Genèse 2, 17 : l'arbre de la connaissance du bien et du mal ; [actes de la 9ème Journée d'exégèse biblique, Strasbourg, 25 avril 2013] | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Journée d'exégèse biblique (09; 2013; Strasbourg), Auteur ; Matthieu Arnold, Editeur scientifique ; Gilbert Dahan, Editeur scientifique ; Annie Noblesse-Rocher, Editeur scientifique ; Institut des études augustiniennes, Editeur scientifique ; Groupe de recherches sur les non-conformismes religieux du XVIème siècle et l'histoire des protestantismes, Editeur scientifique | | Editeur : | Paris : les Éditions du Cerf | | Année de publication : | 2016 | | Collection : | Études d'histoire de l'exégèse, ISSN 2111-7071 num. 9 | | Importance : | 1 vol. (183 p.) | | Format : | 22 cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-204-11033-4 | | Prix : | 20 EUR | | Langues : | Français | | Résumé : | Genèse 2, 17 est un verset qui a été beaucoup commenté et a posé de nombreux problèmes, tant philologiques que doctrinaux. Pourquoi l’interdiction de consommer de cet arbre a-t-elle été faite ? Qu’est-ce que la connaissance du bien et du mal qui lui donne son nom ? Quel est le rapport de cette interdiction avec le libre-arbitre accordé à l’homme ? Au chapitre 3 de la Genèse, le serpent, premier exégète, en donne-t-il une bonne interprétation ? Après avoir examiné le verset dans son contexte biblique, ce volume étudie la tradition d’interprétation qui va des Pères de l’Église au XVIe siècle et fait apparaître des constantes dans les questionnements. Les Pères (notamment Tertullien, Jean Chrysostome, Grégoire de Nazianze), héritant notamment de l’exégèse philonienne, ont eu à répondre aux objections des païens et de leurs adversaires hérétiques, marcionites, gnostiques ou manichéens. L’exégèse médiévale chrétienne développe ses analyses sur le plan de la lettre, de l’exégèse spirituelle et de l’exploitation théologique. Dans les commentaires du XVIe siècle, sont privilégiés les auteurs réunis dans le travail anthologique d’Auguste Marlorat, notamment F. Vatable, J. Œcolampade ou W. Musculus ; une place est également faite à l’exégèse de Martin Luther. À côté de l’approche philosophique faite par Maïmonide et Gersonide, l’exégèse juive envisage surtout la dimension morale ; en dehors des textes rabbiniques et de Rashi, sont examinées les exégèses d’auteurs du XIIIe siècle, comme Nahmanide, et de la fin du moyen âge, Isaac Arama et Isaac Abarbanel. C’est un parcours d’une grande richesse, qui apporte des réponses aux interrogations que nous posons aujourd’hui à propos de ce verset. |
Genèse 2, 17 : l'arbre de la connaissance du bien et du mal ; [actes de la 9ème Journée d'exégèse biblique, Strasbourg, 25 avril 2013] [texte imprimé] / Journée d'exégèse biblique (09; 2013; Strasbourg), Auteur ; Matthieu Arnold, Editeur scientifique ; Gilbert Dahan, Editeur scientifique ; Annie Noblesse-Rocher, Editeur scientifique ; Institut des études augustiniennes, Editeur scientifique ; Groupe de recherches sur les non-conformismes religieux du XVIème siècle et l'histoire des protestantismes, Editeur scientifique . - Paris : les Éditions du Cerf, 2016 . - 1 vol. (183 p.) ; 22 cm. - ( Études d'histoire de l'exégèse, ISSN 2111-7071; 9) . ISBN : 978-2-204-11033-4 : 20 EUR Langues : Français | Résumé : | Genèse 2, 17 est un verset qui a été beaucoup commenté et a posé de nombreux problèmes, tant philologiques que doctrinaux. Pourquoi l’interdiction de consommer de cet arbre a-t-elle été faite ? Qu’est-ce que la connaissance du bien et du mal qui lui donne son nom ? Quel est le rapport de cette interdiction avec le libre-arbitre accordé à l’homme ? Au chapitre 3 de la Genèse, le serpent, premier exégète, en donne-t-il une bonne interprétation ? Après avoir examiné le verset dans son contexte biblique, ce volume étudie la tradition d’interprétation qui va des Pères de l’Église au XVIe siècle et fait apparaître des constantes dans les questionnements. Les Pères (notamment Tertullien, Jean Chrysostome, Grégoire de Nazianze), héritant notamment de l’exégèse philonienne, ont eu à répondre aux objections des païens et de leurs adversaires hérétiques, marcionites, gnostiques ou manichéens. L’exégèse médiévale chrétienne développe ses analyses sur le plan de la lettre, de l’exégèse spirituelle et de l’exploitation théologique. Dans les commentaires du XVIe siècle, sont privilégiés les auteurs réunis dans le travail anthologique d’Auguste Marlorat, notamment F. Vatable, J. Œcolampade ou W. Musculus ; une place est également faite à l’exégèse de Martin Luther. À côté de l’approche philosophique faite par Maïmonide et Gersonide, l’exégèse juive envisage surtout la dimension morale ; en dehors des textes rabbiniques et de Rashi, sont examinées les exégèses d’auteurs du XIIIe siècle, comme Nahmanide, et de la fin du moyen âge, Isaac Arama et Isaac Abarbanel. C’est un parcours d’une grande richesse, qui apporte des réponses aux interrogations que nous posons aujourd’hui à propos de ce verset. |
|  |


 Affiner la recherche
Affiner la rechercheGenèse 2, 17 / Journée d'exégèse biblique (09; 2013; Strasbourg)