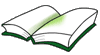A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
Détail d'une collection
|
|
Documents disponibles dans la collection


 Affiner la recherche
Affiner la rechercheLe chant des heures / Serge Tyvaert
Titre : Le chant des heures : Catéchèse et liturgie paroissiale au diocèse de Besançon, 1574-1914. Type de document : texte imprimé Auteurs : Serge Tyvaert, Auteur Editeur : Paris : Éd. du Cerf Année de publication : 2019 Collection : Cerf patrimoines Importance : 1 vol. (913 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-204-13426-2 Langues : Français Mots-clés : Catéchisme, Catéchèse Résumé : L’histoire de la catéchèse en France se réduit généralement à n’être qu’une histoire des catéchismes, conçue de manière uniforme dans tous les diocèses, et étrangement silencieuse sur certaines périodes (1590-1660). La présente enquête, menée sur les ouvrages imprimés, édités ou approuvés entre le XVIe et le XXe siècle par l’archevêque de Besançon et ses relais institutionnels à l’attention des fidèles de son diocèse, fait apparaître l’existence, en Franche-Comté, d’un système pastoral et catéchétique basé sur les institutions éducatives, depuis les petites écoles jusqu’à l’Université en passant par les collèges et les séminaires. La Mission diocésaine comme les congrégations religieuses (Jésuites, Ursulines, ermites de Saint-Jean-Baptiste) y ont pris leur part : depuis la guerre de Dix ans, à Besançon, toutes les institutions devaient contribuer à la transmission de la foi. La première catéchèse était dispensée par les Maîtres et Maîtresses au moyen de livres d’Heures conçus pour être employés tant à l’école, pour apprendre à lire, à l’église, pour participer à la liturgie paroissiale, qu’à la maison, pour savoir bien vivre. Ces ouvrages ont permis à de nombreux franc-comtois d’exercer une forte résistance religieuse et culturelle durant la Révolution française. Le ralliement du diocèse à la liturgie Romaine en 1875, l’adoption concomitante du système catéchétique sulpicien, et la laïcisation de l’Instruction publique lui ont porté un coup fatal. Loin de se limiter à n’être qu’une étude littéraire consacrée à l’histoire des idées ou des mentalités, le Chant des Heures se présente également comme une galerie de portraits où trouvent place petits et grands, à travers lesquels a pris chair le système pastoral bisontin. Le chant des heures : Catéchèse et liturgie paroissiale au diocèse de Besançon, 1574-1914. [texte imprimé] / Serge Tyvaert, Auteur . - Paris : Éd. du Cerf, 2019 . - 1 vol. (913 p.) ; 23 cm. - (Cerf patrimoines) .
ISBN : 978-2-204-13426-2
Langues : Français
Mots-clés : Catéchisme, Catéchèse Résumé : L’histoire de la catéchèse en France se réduit généralement à n’être qu’une histoire des catéchismes, conçue de manière uniforme dans tous les diocèses, et étrangement silencieuse sur certaines périodes (1590-1660). La présente enquête, menée sur les ouvrages imprimés, édités ou approuvés entre le XVIe et le XXe siècle par l’archevêque de Besançon et ses relais institutionnels à l’attention des fidèles de son diocèse, fait apparaître l’existence, en Franche-Comté, d’un système pastoral et catéchétique basé sur les institutions éducatives, depuis les petites écoles jusqu’à l’Université en passant par les collèges et les séminaires. La Mission diocésaine comme les congrégations religieuses (Jésuites, Ursulines, ermites de Saint-Jean-Baptiste) y ont pris leur part : depuis la guerre de Dix ans, à Besançon, toutes les institutions devaient contribuer à la transmission de la foi. La première catéchèse était dispensée par les Maîtres et Maîtresses au moyen de livres d’Heures conçus pour être employés tant à l’école, pour apprendre à lire, à l’église, pour participer à la liturgie paroissiale, qu’à la maison, pour savoir bien vivre. Ces ouvrages ont permis à de nombreux franc-comtois d’exercer une forte résistance religieuse et culturelle durant la Révolution française. Le ralliement du diocèse à la liturgie Romaine en 1875, l’adoption concomitante du système catéchétique sulpicien, et la laïcisation de l’Instruction publique lui ont porté un coup fatal. Loin de se limiter à n’être qu’une étude littéraire consacrée à l’histoire des idées ou des mentalités, le Chant des Heures se présente également comme une galerie de portraits où trouvent place petits et grands, à travers lesquels a pris chair le système pastoral bisontin. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0079555 8R2469 Livres Magasin Régional Disponible La croisée des signes / Vincent Debiais
Titre : La croisée des signes : L'écriture et les images médiévales (800-1200) Type de document : texte imprimé Auteurs : Vincent Debiais (1978-....), Auteur Editeur : Paris : Éd. du Cerf Année de publication : 2017 Collection : Cerf patrimoines Importance : 1 vol. (368 p.) Présentation : Photogr. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-204-11539-1 Prix : 34 EUR Résumé : L'écriture est omniprésente dans les images médiévales. Ce constat, celui d'une évidence, a alimenté un pan entier de la médiévistique au cours des trente dernières années, celui de l'étude des relations entre le texte et l'image. Le présent ouvrage envisage à nouveaux frais ces questions en les abordant au prisme de la coprésence des signes alphabétiques et iconiques au sein d'une même image, qu'elle soit peinte sur l'enduit ou sur le verre, sculptée dans la pierre ou le métal, composée en mosaïque ou en textile. En analysant les dispositifs de l'inscription, sa forme, sa localisation et son contenu, cette étude propose de dépasser le constat de l'omniprésence de l'écriture dans l'image pour interroger les conditions et les effets de cette rencontre. Les considérations théologiques et les réflexions patristiques éclairent les intentions et les conditions de la présence conjointe du texte et de l'image au sein d'une même construction visuelle. Sur cette toile de fond intellectuelle se met en place une mécanique du sens entre imago et littera, qui dépasse les fonctions strictes d'identification, de commentaire ou de glose. L'émergence d'une signification augmentée de l'image, voire d'une image nouvelle, se produit dans la friction du texte et de l'image, et l'écriture devient partie intégrante du processus de création du visuel. A partir d'exemples produits entre 800 et 1200, cette étude met en perspective les pratiques artistiques et épigraphiques avec la théologie de l'image. Elle étudie ces objets qui traduisent dans le matériau la réflexion médiévale sur les capacités respectives de l'écriture et de l'image à mettre en signe l'étendue de la Création et l'histoire du monde. La croisée des signes : L'écriture et les images médiévales (800-1200) [texte imprimé] / Vincent Debiais (1978-....), Auteur . - Paris : Éd. du Cerf, 2017 . - 1 vol. (368 p.) : Photogr. ; 23 cm. - (Cerf patrimoines) .
ISBN : 978-2-204-11539-1 : 34 EUR
Résumé : L'écriture est omniprésente dans les images médiévales. Ce constat, celui d'une évidence, a alimenté un pan entier de la médiévistique au cours des trente dernières années, celui de l'étude des relations entre le texte et l'image. Le présent ouvrage envisage à nouveaux frais ces questions en les abordant au prisme de la coprésence des signes alphabétiques et iconiques au sein d'une même image, qu'elle soit peinte sur l'enduit ou sur le verre, sculptée dans la pierre ou le métal, composée en mosaïque ou en textile. En analysant les dispositifs de l'inscription, sa forme, sa localisation et son contenu, cette étude propose de dépasser le constat de l'omniprésence de l'écriture dans l'image pour interroger les conditions et les effets de cette rencontre. Les considérations théologiques et les réflexions patristiques éclairent les intentions et les conditions de la présence conjointe du texte et de l'image au sein d'une même construction visuelle. Sur cette toile de fond intellectuelle se met en place une mécanique du sens entre imago et littera, qui dépasse les fonctions strictes d'identification, de commentaire ou de glose. L'émergence d'une signification augmentée de l'image, voire d'une image nouvelle, se produit dans la friction du texte et de l'image, et l'écriture devient partie intégrante du processus de création du visuel. A partir d'exemples produits entre 800 et 1200, cette étude met en perspective les pratiques artistiques et épigraphiques avec la théologie de l'image. Elle étudie ces objets qui traduisent dans le matériau la réflexion médiévale sur les capacités respectives de l'écriture et de l'image à mettre en signe l'étendue de la Création et l'histoire du monde. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0077875 8J1948 Livres Magasin Histoire Disponible Eglise, gens d'Eglise et identité comtoise / Henri Moreau
Titre : Eglise, gens d'Eglise et identité comtoise : La Franche-Comté au XVIIe siècle Type de document : texte imprimé Auteurs : Henri Moreau, Auteur Editeur : Paris : Éd. du Cerf Année de publication : 2019 Collection : Cerf patrimoines Importance : 1 vol. (1104 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-204-11854-5 Langues : Français Résumé : Située au cœur de l’Europe, la Franche-Comté a subi au dix-septième siècle la terrible épreuve de la guerre de Trente ans avec la perte de la moitié de sa population. Elle sera repeuplée par une immigration française, savoyarde, lorraine et suisse. Province autonome faisant partie de l’empire des Habsbourg, sa constitution politique repose sur trois fondements : la succession héréditaire, le principe de catholicité et le libre consentement à l’impôt. À chaque nouveau règne, un échange solennel de serments entre les représentants du souverain et les États de la province scelle les engagements réciproques. L’archevêque de Besançon et la cité de Besançon siègent à la diète d’Empire, qui se réunit à cette époque à Ratisbonne. Besançon et la Franche-Comté sont en relation permanente avec les centres de pouvoir de Madrid, de Bruxelles, de Vienne et de Rome. Seule sur le territoire de la France actuelle avec les États pontificaux d’Avignon, la Franche-Comté dispose d’un inquisiteur de la foi de plein exercice. Terre de contradictions, elle est à la fois la patrie d’Henri Boguet, qui s’est illustré dans la répression de la sorcellerie, et celle du médecin bisontin Ferdinand Bouvot, dont la critique des procès de sorcellerie entraînera leur disparition. Eglise, gens d'Eglise et identité comtoise : La Franche-Comté au XVIIe siècle [texte imprimé] / Henri Moreau, Auteur . - Paris : Éd. du Cerf, 2019 . - 1 vol. (1104 p.) ; 23 cm. - (Cerf patrimoines) .
ISBN : 978-2-204-11854-5
Langues : Français
Résumé : Située au cœur de l’Europe, la Franche-Comté a subi au dix-septième siècle la terrible épreuve de la guerre de Trente ans avec la perte de la moitié de sa population. Elle sera repeuplée par une immigration française, savoyarde, lorraine et suisse. Province autonome faisant partie de l’empire des Habsbourg, sa constitution politique repose sur trois fondements : la succession héréditaire, le principe de catholicité et le libre consentement à l’impôt. À chaque nouveau règne, un échange solennel de serments entre les représentants du souverain et les États de la province scelle les engagements réciproques. L’archevêque de Besançon et la cité de Besançon siègent à la diète d’Empire, qui se réunit à cette époque à Ratisbonne. Besançon et la Franche-Comté sont en relation permanente avec les centres de pouvoir de Madrid, de Bruxelles, de Vienne et de Rome. Seule sur le territoire de la France actuelle avec les États pontificaux d’Avignon, la Franche-Comté dispose d’un inquisiteur de la foi de plein exercice. Terre de contradictions, elle est à la fois la patrie d’Henri Boguet, qui s’est illustré dans la répression de la sorcellerie, et celle du médecin bisontin Ferdinand Bouvot, dont la critique des procès de sorcellerie entraînera leur disparition. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0079533 8R2468 Livres Magasin Régional Disponible Miséricorde n'est pas défaut de justice / Eunsil Son
Titre : Miséricorde n'est pas défaut de justice : Savoir humain, révélation évangélique et justice divine chez Thomas d'Aquin Type de document : texte imprimé Auteurs : Eunsil Son (1965-....), Auteur ; Gilles (O.P.) Berceville, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Éd. du Cerf Année de publication : 2018 Collection : Cerf patrimoines Importance : 1 vol. (385 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-204-12200-9 Prix : 34 EUR Langues : Français Mots-clés : Miséricorde, Justice, Thomas d'Aquin Résumé : L’explication de la justice divine comme justice distributive, que Thomas d’Aquin donne dans les textes des deux Sommes consacrés à ce sujet, avant de prendre explicitement en compte l’œuvre du Christ, semble prêter le flanc au reproche adressé à la scolastique par Heidegger, se référant explicitement à Luther : « La scolastique, dit il, ne prend que rétrospectivement connaissance du Christ, après avoir déterminé l’être de Dieu et du monde. Cette perspective grecque des scolastiques rend l’homme fier ; il doit d’abord aller à la croix avant de dire “id quod res est”. » En traitant de la justice divine, Thomas met-il en œuvre une épistémologie théologique d’inspiration philosophique grecque, une « théologie de la gloire », au sens défi ni par Luther ? Quelle place attribue-t-il à la croix dans la connaissance humaine de Dieu ? Eunsil Son se livre à une lecture des œuvres de Thomas d’Aquin traitant de la justice divine, ses commentaires bibliques d’une part, ses grandes œuvres de synthèse d’autre part. Elle confronte la doctrine de Thomas ainsi dégagée dans son enracinement biblique et sa cohérence théologique à celle de Luther. Cette confrontation met en lumière le déplacement de perspective opéré entre Thomas et les modernes, et enrichit le débat œcuménique, permettant « de mieux comprendre, et de mieux estimer Thomas et Luther, non plus l’un contre l’autre, mais l’un par l’autre ». Eunsil Son est professeur à l’université presbytérienne et au séminaire théologique de Séoul. Elle est aussi pasteur ordonné dans l’Église presbytérienne de Corée du Sud. Miséricorde n'est pas défaut de justice : Savoir humain, révélation évangélique et justice divine chez Thomas d'Aquin [texte imprimé] / Eunsil Son (1965-....), Auteur ; Gilles (O.P.) Berceville, Préfacier, etc. . - Paris : Éd. du Cerf, 2018 . - 1 vol. (385 p.) ; 23 cm. - (Cerf patrimoines) .
ISBN : 978-2-204-12200-9 : 34 EUR
Langues : Français
Mots-clés : Miséricorde, Justice, Thomas d'Aquin Résumé : L’explication de la justice divine comme justice distributive, que Thomas d’Aquin donne dans les textes des deux Sommes consacrés à ce sujet, avant de prendre explicitement en compte l’œuvre du Christ, semble prêter le flanc au reproche adressé à la scolastique par Heidegger, se référant explicitement à Luther : « La scolastique, dit il, ne prend que rétrospectivement connaissance du Christ, après avoir déterminé l’être de Dieu et du monde. Cette perspective grecque des scolastiques rend l’homme fier ; il doit d’abord aller à la croix avant de dire “id quod res est”. » En traitant de la justice divine, Thomas met-il en œuvre une épistémologie théologique d’inspiration philosophique grecque, une « théologie de la gloire », au sens défi ni par Luther ? Quelle place attribue-t-il à la croix dans la connaissance humaine de Dieu ? Eunsil Son se livre à une lecture des œuvres de Thomas d’Aquin traitant de la justice divine, ses commentaires bibliques d’une part, ses grandes œuvres de synthèse d’autre part. Elle confronte la doctrine de Thomas ainsi dégagée dans son enracinement biblique et sa cohérence théologique à celle de Luther. Cette confrontation met en lumière le déplacement de perspective opéré entre Thomas et les modernes, et enrichit le débat œcuménique, permettant « de mieux comprendre, et de mieux estimer Thomas et Luther, non plus l’un contre l’autre, mais l’un par l’autre ». Eunsil Son est professeur à l’université presbytérienne et au séminaire théologique de Séoul. Elle est aussi pasteur ordonné dans l’Église presbytérienne de Corée du Sud. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0078771 8P2637 Livres Magasin Philosophie Disponible Saint Irénée et l'humanité illuminée / Elie Ayroulet
Titre : Saint Irénée et l'humanité illuminée Type de document : texte imprimé Auteurs : Elie Ayroulet, Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Paris : Éd. du Cerf Année de publication : 2018 Collection : Cerf patrimoines Importance : 1 vol. (266 p.) Format : 21,5 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-204-13269-5 Langues : Français Mots-clés : Irénée de Lyon (130-202) Résumé : Cet ouvrage rassemble une série de communications données au cours d’un symposium international et oecuménique sur saint Irénée (130-202) qui s’est tenu en Égypte en décembre 2016 dans le centre spirituel copte d’Anafora sous le patronage du cardinal archevêque de Lyon Philippe Barbarin et du pope copte orthodoxe Tawadros II. Abordant sous l’angle original de la thématique de « l’humanité illuminée » l’anthropologie théologique du deuxième évêque de Lyon, l’ensemble de ces études, sans prétendre à une totale nouveauté, permettra à un public cultivé et pas forcément spécialiste de découvrir une dimension essentielle de la pensée irénéenne. Les contributions sont réparties en deux grands ensembles. Le premier traite directement du thème de « l’illumination de l’homme » dans la théologie d’Irénée, et le second porte sur la réception de cette thématique dans la tradition théologique postérieure. Chacun des contributeurs à cet ouvrage est spécialiste de la pensée des Pères de l’Église et certains plus spécifiquement de celle d’Irénée de Lyon. Saint Irénée et l'humanité illuminée [texte imprimé] / Elie Ayroulet, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Éd. du Cerf, 2018 . - 1 vol. (266 p.) ; 21,5 cm. - (Cerf patrimoines) .
ISBN : 978-2-204-13269-5
Langues : Français
Mots-clés : Irénée de Lyon (130-202) Résumé : Cet ouvrage rassemble une série de communications données au cours d’un symposium international et oecuménique sur saint Irénée (130-202) qui s’est tenu en Égypte en décembre 2016 dans le centre spirituel copte d’Anafora sous le patronage du cardinal archevêque de Lyon Philippe Barbarin et du pope copte orthodoxe Tawadros II. Abordant sous l’angle original de la thématique de « l’humanité illuminée » l’anthropologie théologique du deuxième évêque de Lyon, l’ensemble de ces études, sans prétendre à une totale nouveauté, permettra à un public cultivé et pas forcément spécialiste de découvrir une dimension essentielle de la pensée irénéenne. Les contributions sont réparties en deux grands ensembles. Le premier traite directement du thème de « l’illumination de l’homme » dans la théologie d’Irénée, et le second porte sur la réception de cette thématique dans la tradition théologique postérieure. Chacun des contributeurs à cet ouvrage est spécialiste de la pensée des Pères de l’Église et certains plus spécifiquement de celle d’Irénée de Lyon. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0078863 8E641 Livres Magasin Patristique Disponible